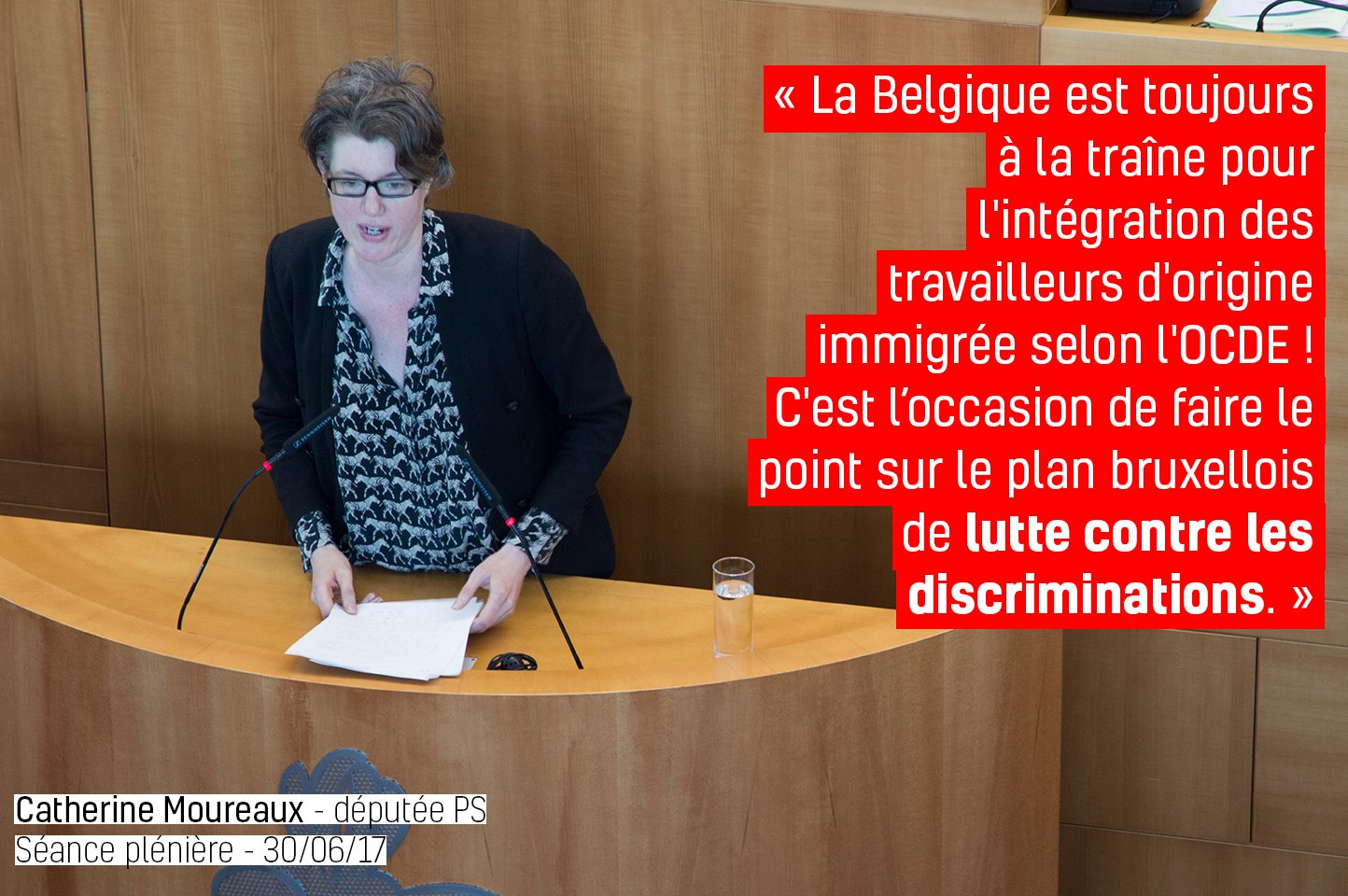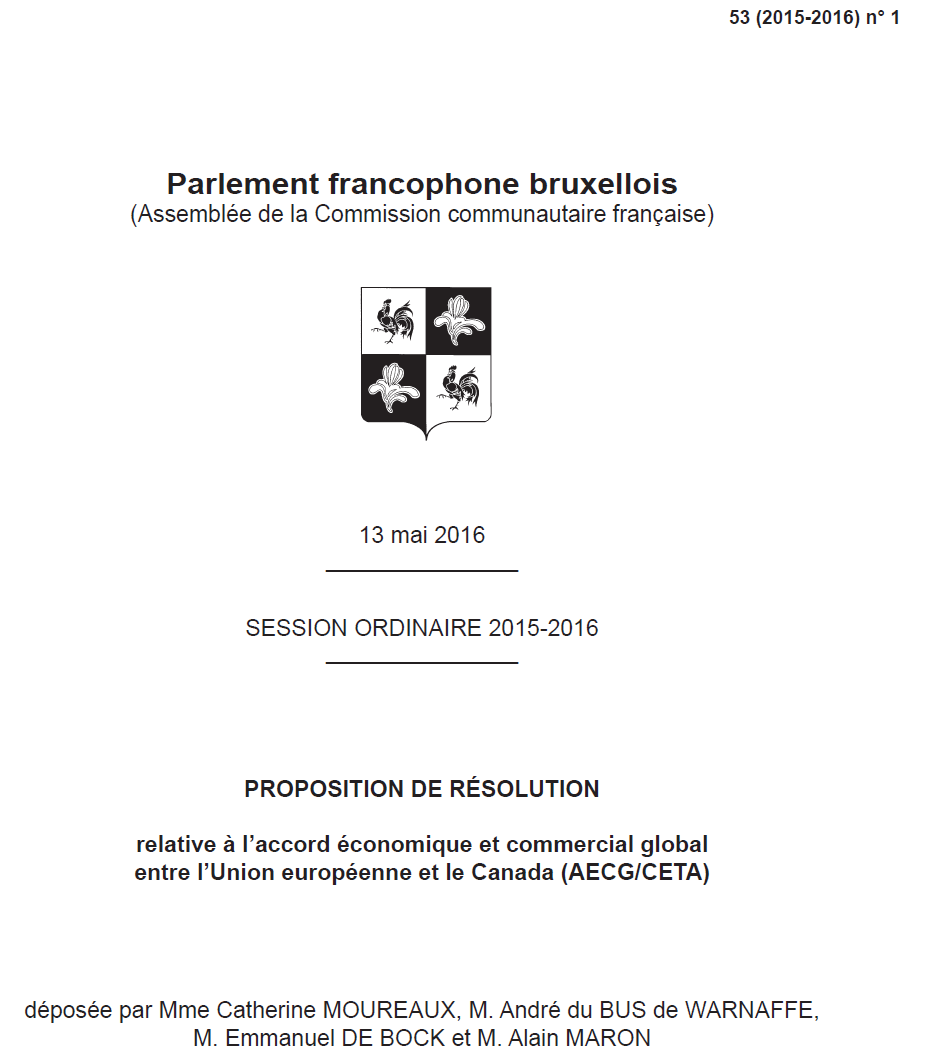En quoi le sentiment de sécurité est-il un enjeu pour la santé des Bruxellois ? Santé et sécurité sont deux enjeux prépondérants dans les grandes villes dont on aurait tort de ne pas souligner l’interdépendance. Le lien le plus évident se fait entre santé mentale et sécurité, mais pour les femmes, en plus, il existe un lien direct entre sécurité dans l’espace public et exercice physique. Ainsi, à propos de la fréquentation des parcs publics, les récentes marches exploratoires de l’asbl Garance ont mis au jour les limites rencontrées et les stratégies d’évitement utilisées dans ces espaces propices aux loisirs. Les fonctions et la fréquentation des parcs par les Bruxellois varient en fait fortement selon le genre. Quand on est une femme, la durée passée sur place est considérablement réduite, notamment en raison de l’absence de toilettes publiques. La baisse de la luminosité ou l’aménagement en espaces enclavés renforcent le sentiment d’insécurité des femmes et la conviction intériorisée qu’il ne s’agit pas d’endroits « où elles doivent se trouver ». C’est ainsi que les jeunes filles, à partir de 10 ans, disparaissent peu à peu des parcs, abandonnant les activités sportives qu’elles y pratiquaient enfants. Les parcours santé ou les modules sportifs, car souvent placés en vis-à-vis des bancs publics, en privent les femmes d’un usage confortable. L’offre d’une activité sportive gratuite et de proximité échappe donc en partie aux femmes, ne laissant place qu’à la garde des enfants. La dimension de genre met en lumière une interdépendance concrète entre sentiment de sécurité et santé. Répondre à cette inégalité d’appropriation de l’espace public nécessite une prise de conscience collective, une (ré) appropriation quotidienne mais aussi une mise en œuvre toujours plus effective du gender mainstreaming initié depuis 2012 par la Région. Ceci afin de favoriser la santé de pas moins de la moitié des Bruxellois! Catherine Moureaux Présidente du Groupe PS au Parlement francophone bruxellois, Députée bruxelloise et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Cet article est paru dans Bruxelles Santé n°88 – Décembre 2017: http://questionsante.org
Discrimination à l’embauche : L’OCDE pointe à nouveau la faiblesse belge !
Ce vendredi 30 juin 2017, j’ai interrogé le Ministre bruxellois de l’emploi sur le rapport OCDE sur notre marché de l’emploi. L’occasion de faire le point sur la mise en ouvre du plan bruxellois de lutte contre la discrimination à l’embauche. L’OCDE pointe tout particulièrement, et c’est dans la continuité de ses rapports précédents, un écart magistral entre les taux d’emploi des immigrés “non-européens de deuxième génération” (48.7%) et celui des “autochtones” (69.7%). Cet écart est parmi les plus élevés de l’Union européenne ! Alors où en est notre plan bruxellois de lutte contre la discrimination à l’embauche? Voici les grandes lignes de la réponse du Ministre. 1/L’ordonnance anti-discrimination devrait passer en troisième lecture au Gouvernement la semaine prochaine ! Youpie !!! Pour rappel c’est le texte de loi qui devrait permettre aux inspecteurs régionaux de pratiquer du testing des employeurs. 2/Le Ministre a bien envoyé des travailleurs supplémentaires pour aider les services de la Communauté en matière d’équivalence. 3/Le monitoring bruxellois est sur le métier à Actiris (on n’a pas les moyens aujourd’hui de produire des statistiques “bruxello-bruxelloises”). Mais il s’agit seulement d’une étape de “faisabilité”… En conclusion, la lutte contre la discrimination avance même si c’est un mouvement lent.
Défendons les enseignants dans la nouvelle étape de réforme des pensions du gouvernement MR-NVA ! – Mon intervention
Ce 12 mai 2017, en tant que cheffe de groupe du Parti Socialiste, j’ai porté la motion en conflit d’intérêt au Parlement Francophone bruxellois pour faire barrage au texte du MR sur le rachat des années d’étude ! Il faut que le MR se ressaisisse car les enseignants ont besoin de notre soutien à tous! Mon intervention : « Enclencher le mécanisme de motion en conflit d’intérêt n’a rien d’anodin. Si plusieurs partis ont décidé de le faire, c’est parce qu’il nous est possible de défendre les enseignants. Mais je voudrais d’abord revenir sur le contexte général des réformes en pensions. Dans les coulisses du Kazakgate et de Publifin un lent et patient travail est accompli sur les pensions. Son objectif ? Harmoniser les régimes de pension et faire des économies. Plus précisément à l’horizon 2060 faire 731 millions d’euros d’économie par an, tous secteurs confondus, dans cette seule branche « pensions ». Et sur ces 731 millions d’économie, 706 millions – soit 96% des économies- se feraient sur les pensions du secteur public ! Harmonisation oui, mais au prix d’une réforme qui nivelle vers le bas de manière radicale ! Je vous parlais d’un lent et patient travail, ce sont des qualificatifs qu’on pourrait croire positifs. Le problème, outre l’analyse globale que je viens de vous proposer, c’est que la réforme avance par petits pas, sans que du coup on soit capable d’en comprendre la portée précise finale. La réforme avance à petits pas, dans une matière très technique, où la communication peut faire passer des vessies pour des lanternes. Lanternes qui malheureusement n’éclairent pas le bout du tunnel 😉 Aujourd’hui, pour un métier, nous sommes particulièrement préoccupés et nous avons l’opportunité de nous mobiliser, ici en Commission communautaire Française! Il s’agit de nos enseignants. Ainsi en entendant M.Bacquelaine, on pense que les enseignants déjà en place sont en grande partie protégés de la réforme, mais en lisant la note de M.Bacquelaine, on lit bien que ce ne sont que les enseignants déjà en situation de prépension ou de possibilité de prépension au 1er juin 2017, et que ceux qui sont déjà largement entrés dans la carrière devront racheter des années d’étude. Qui aujourd’hui doute encore du rôle primordial des enseignants dans notre société ? Qui croit que ce qu’a décidé le fédéral avec la pension des enseignants n’aura aucun impact sur l’avenir du secteur ? Travailler jusqu’à 68 ans, qui croit que cela créera des vocations ? Chers collègues, « choisir c’est renoncer ». Et en choisissant d’opérer une telle réforme sans concertation, le Gouvernement Fédéral et ici peut-être aussi, le Groupe MR, renonce à la défense des enseignants, à un enseignement de qualité. Il renonce en réalité à une partie de son programme. Ce dernier prévoyait de lutter contre la pénurie d’enseignants en attirant et en retenant justement ceux-ci ! Car le programme 2014 de votre Parti Monsieur Vangoidsenhoven précisait ceci : « Retenir les enseignants demande en priorité des conditions de travail sereines dans toutes les classes. Restaurer l’attractivité du métier pour revaloriser notre système éducatif implique que les efforts portent à la fois sur la formation et le statut socio-économique de l’enseignant. En effet, l’indice socio-économico-culturel du personnel de l’école influence les résultats de manière plus importante que l’indice socio-économique des élèves, et les systèmes les plus performants tendent à donner la priorité au salaire des enseignants et non à la réduction de la taille des classes ». Vous étiez alors préoccupés du statut socio-économique de l’enseignant, du salaire des enseignants ! Jugez-vous sérieusement que la réforme annoncée par vos collègues du fédéral va dans ce sens ? Le sens de vos valeurs reprises dans votre programme ? Est-ce que vous pensez que cette mesure va améliorer la qualité de l’enseignement ? C’est à cette question que vous devez répondre au moment de choisir ce que vous voterez sur cette motion ! Aujourd’hui, l’inquiétude est là. Rien ne garantit aux enseignants l’âge de la pension, ni la reconnaissance de la pénibilité de leur travail, qui était aussi dans votre programme, je pense. Les femmes, avec leur carrière souvent incomplète, et les temps partiels seront les premières victimes de toute mesure inconsidérée en matière de pension des enseignants. L’enseignement est l’un des métiers les plus exigeants qui soit. C’est même un métier épuisant : stress, angoisses, solitude… D’où les départs anticipés, la perte d’attractivité. Il faut inverser la tendance ! Nous devons garantir aux enseignants une formation adaptée à la réalité et reconnaître la pénibilité. Or le budget que vous avez prévu pour la réforme des tantièmes et de la pénibilité aujourd’hui ne pourrait suffire pour les enseignants. La logique strictement budgétaire vous amène dans une impasse. Vous demandez aux partenaires sociaux de négocier dans une enveloppe déjà fermée. Qui en toute hypothèse ne pourrait pas contenir les enseignants… Nous ne pouvons accepter un chat dans un sac dans ce dossier. Il faut aborder la pénibilité en même temps que cette réforme. Il faut intégrer toutes les réformes pensions pour appréhender ce quii va arriver à nos enseignants. Pour cela nous avons besoin de temps. Pour cela nous avons besoin de concertation. Une vraie concertation, pas une présentation des mesures et puis allez hop c’est emballé, c’est pesé. Au nom de mon groupe, j’espère que le dialogue sur ce sujet se tiendra rapidement. Je tiens à le rappeler une dernière fois : les enseignants ont besoin de tout notre soutien ! Nous savons que la situation de Bruxelles est particulière. Le boom démographique mais aussi une hausse de la précarité de sa population nous renforcent dans l’idée qu’aujourd’hui comme demain le corps enseignant devra relever de nombreux défis. Pour cela il faut du personnel dynamique, enthousiaste, aimant son travail et non pas des enseignants usés, lésé par un gouvernement fédéral qui donne l’impression de les mépriser. Légiférer dans la précipitation, et sans concertation, n’est jamais bon. Le dialogue avec le secteur de l’enseignement est inexistant dans cette réforme. C’est un manque de respect. Nous le savons, la culture de concertation et du dialogue n’est pas acquise chez le partenaire privilégié du MR au fédéral (la NVA). Foncer, imposer, fragiliser …c’est
57 ans après, début de la reconnaissance de la ségrégation des métis issus de la colonisation belge
Ce vendredi 24 février, nous avons adopté la résolution concernant la ségrégation ciblée à l’encontre des métis issus de la colonisation belge et ses conséquences dramatiques, en ce compris les adoptions forcées en commission du budget du Parlement francophone bruxellois. Mon intervention et la résolution ci-dessous: Madame la présidente, chers collègues, Je suis très heureuse, et très fière, de pouvoir apporter mon soutien au texte de résolution qui est aujourd’hui à l’ordre du jour. Nous sommes aujourd’hui en présence de quelque chose de plus qu’une résolution. C’est un travail d’introspection. Ce texte nous permet en effet de réaliser un examen de conscience de ce que nous sommes – nous élus du peuple belge. Quel bilan pouvons-nous tirer des accomplissements – glorieux comme odieux – de la société que nous représentons, aujourd’hui comme dans le passé ? Est-ce que nous utilisons à bon escient cette petite part de représentativité temporaire et de cette confiance dont nos concitoyens nous gratifient ? Est-ce que les institutions que nous bâtissons jour après jour servent toujours au mieux notre société ? Est-ce que nous les améliorons ? Est-ce qu’elles ont toujours été exemplaires ? Est-ce qu’aujourd’hui nous pouvons regarder droit dans les yeux nos amis de l’Association des Métis de Belgique et leur dire que tout va bien et que nous sommes droits dans nos bottes, avec la paix dans l’âme ? La réponse est évidemment non. Au cours des derniers mois nous nous sommes plongés, au cours de nombreuses réunions de travail, en lisant les ouvrages comme celui d’Assumani Budagawa, dans notre propre passé. Il y a un petit siècle à peine, notre société belge, bourgeoise, positiviste, instruite, civilisée, industrialisée, organisait un régime par bien des aspects criminel. Notre res publica constitutionnelle, parlementaire et démocratique perpétrait des crimes en-dehors de ses frontières. La main sur le cœur, un exemplaire de notre Constitution libérale consacrant les droits de l’Homme dans l’autre main, le colonisateur belge bâtissait ses institutions prétendument modernisatrices. Un crime auquel tout le monde se livre et dont personne ne s’émeut perd son statut de crime, c’est-à-dire de tabou interdit et sanctionné par la société. L’exploitation des richesses naturelles et des populations d’Afrique était légitimée par une idéologie raciste qui travestissait le crime avec un voile d’œuvre civilisatrice. Non seulement le crime n’était plus le crime, mais il était même un apport de civilisation à ceux qui en étaient privés. Le crime était donc positif. Chers collègues, Nous sommes aujourd’hui très loin d’avoir fait le bilan de tous les méfaits commis en Afrique et de par le monde dans le contexte du colonialisme. À mesure que cette période s’éloigne de nous, les crimes de nos aïeuls deviennent une abstraction pour des gens qui ne les comprennent pas ou ne les connaissent pas. La psychique est ainsi faite que nous avons tendance à oublier nos défauts et nos erreurs pour construire une image favorable de nous-mêmes ou de la communauté humaine à laquelle nous appartenons. Dans ce contexte la facilité tendrait à nous amener à oublier les crimes du passé de notre pays. C’est plus confortable de balayer cela sous le tapis, d’autant plus que bientôt plus aucun témoin, victime ni auteur de ces crimes ne sera plus là pour en parler. Ce n’est pas ainsi que je fonctionne, et ce n’est pas ainsi que fonctionne mon Parti. Ce n’est en principe même pas la philosophie sur laquelle notre pays est fondé. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». C’est le libellé de l’article 1382 du Code civil, en vigueur dans nos régions depuis plus longtemps que notre Constitution. La philosophie dont cette courte phrase est porteuse est à la base de l’ordre auquel l’État belge est également soumis. Cela veut dire qu’aujourd’hui l’État belge est tenu de réparer les crimes commis en son nom par le passé. La première chose est de reconnaître ces crimes et les dommages, les souffrances qu’ils ont causé à leurs victimes, parmi lesquelles figurent les métis. Chers amis, Nous vous avons entendu. Nous vous avons compris. Nous reconnaissons pleinement vos souffrances et le lien de causalité entre celles-ci et les crimes que nos aïeuls ont perpétré au nom de l’État belge. À la modeste échelle de la Commission Communautaire Française, de son Assemblée que nous formons, et des compétences dont elle est dépositaire, en notre qualités de citoyens, d’élus, de libre-exaministes et de démocrates nous initions aujourd’hui un travail commun. Un travail de mémoire tout d’abord. Un travail de conscientisation et de renversement de la tendance. Par notre résolution d’aujourd’hui nous posons les jalons d’une enquête scientifique qui donnera lieu à une reconnaissance des crimes, à des excuses officielles et à des réparations. La finalité de l’article 1382 du Code civil que j’ai cité est la restauration d’un équilibre rompu, de serait-ce que de manière symbolique, par une compensation. Comment rendre à un homme ou à une femme les années passées loin de sa mère ? Le minimum c’est de l’aider à la retrouver. Le temps n’a malheureusement pas attendu. Certains ne retrouveront peut-être pas leur mère. Mais il est dans l’obligation de l’État belge de leur fournir des réponses à leurs questions. Qui suis-je comme individu ? Quel nom est-ce que je porte ? Est-ce qu’il y en a beaucoup d’autres dans ma situation, se posant les mêmes questions ? Ai-je un frère ou une sœur quelque part, dont j’ignore l’existence ? Je suis aujourd’hui fière que le Parlement francophone Bruxellois écrive aujourd’hui la première page d’un chapitre, que nous espérons plus heureux, de la vie des métis que l’État belge a bouleversé et assombri dès leur naissance. Je remercie mes collègues de la majorité comme de l’opposition pour ce travail commun qui se poursuivra dans d’autres assemblées parlementaires de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez la résolution en cliquant sur ce lien: résolution concernant la ségrégation ciblée à l’encontre des métis issus de la colonisation belge et ses conséquences dramatiques, en ce compris les adoptions forcées
Les CPAS doivent aider les étudiants!
Ce 21/12/2016, j’ai interpellé en commission la Ministre compétente pour la Politique d’Aide aux Personnes sur l’augmentation toujours plus importante d’étudiants bénéficiant du revenu d’intégration sociale: « Madame la Ministre, En juillet dernier, je vous interrogeais sur la hausse sans précédent du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS). Aujourd’hui, si, comme vous le rappeliez, un bruxellois sur trois est en risque de pauvreté, nous constatons que les CPAS sont par ailleurs confrontés à un afflux inédit d’étudiants. Le nombre de ceux-ci aurait doublé en 10 ans, passant de 7.239 en 2006 à 14.867 en 2016. Les étudiants représenteraient maintenant près de 15 % du nombre total de bénéficiaires belges du RIS. Deux Ministres se sont déjà prononcés sur cette question. Willy Borsus en charge de l’Intégration sociale au fédéral a dit : « J’ai entamé une réflexion sur le sujet. Je souhaite que l’accès aux études des familles les plus pauvres soit garanti, mais je m’interroge sur des situations spécifiques, par exemple quand des parents sont à l’étranger. Je compte faire des propositions aux fédérations de CPAS début 2017. ». Pour moi cette déclaration jette le trouble. Je suis rejointe sur ce constat par le Ministre Marcourt, responsable de l’enseignement supérieur en Communauté française, que j’ai interrogé sur le sujet en plénière : il s’étonne de cette déclaration et « fera des propositions au Ministre Borsus pour qu’il s’inscrive dans une politique de soutien plutôt que d’exclusion ». Jean-Claude Marcourt m’a par ailleurs répondu que dans l’enseignement obligatoire le nombre de jeunes bénéficiant du RIS est en augmentation encore plus nette. Ceci est un élément marquant et encore à développer. Dans ce contexte, sachant que Bruxelles est la première ville étudiante du pays avec plus de 90.000 étudiants dans l’enseignement supérieur et que les loyers y sont particulièrement élevés, il est plus que probable qu’elle soit particulièrement touchée par cette augmentation. Face à cette situation très préoccupante, Madame la Ministre, je voudrais vous interroger largement sur les mesures spécifiques mises en place pour lutter contre la pauvreté des étudiants, et sur le dialogue avec le fédéral en la matière. Ainsi je souhaiterais aborder notamment les axes suivants : Quelle est la situation spécifique à Bruxelles ? Aujourd’hui, certains de nos CPAS doivent être plus particulièrement sollicités par les étudiants. Quels sont-ils ? Comment cet afflux influence-t-il leur situation financière ? Où en est la mise en œuvre du projet individualisé d’intégration sociale pour les étudiants dans chacun des CPAS bruxellois ? Comment chaque CPAS gère-t-il le PIS et les études ou la reprise d’études ? Quel dialogue existe entre vous et le fédéral sur cette problématique des étudiants qui touche particulièrement notre Région? Je vous remercie pour les réponses que vous pourrez me fournir. » Vous retrouverez la réponse de la Ministre ci-dessous dès que celle-ci sera disponible.
Comment accompagner les personnes qui sont sorties de la rue?
Vous pouvez lire ci-dessous le compte rendu de ma question concernant « l’étude de la fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri sur l’accompagnement dans le cadre du post-hébergement » que j’ai posée à la Ministre compétente le 9 novembre 2016: Mme Catherine Moureaux (PS).- L’Association des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) a diffusé, la semaine passée, une étude intitulée « Le post hébergement – un accompagnement pour favoriser la transition vers un nouveau milieu de vie ». L’accompagnement post-hébergement est indispensable, pour certaines familles, au passage de relais après plusieurs semaines ou plusieurs mois d’hébergement. Depuis de nombreuses années, l’AMA revendique la reconnaissance de cette pratique d’accompagnement existant depuis plus de 20 ans. Pour étayer son plaidoyer, cette association vient de sortir une enquête réalisée entre fin 2015 et début 2016. Celle-ci a fait l’objet de réflexions avec des acteurs de terrain au printemps qui ont encore complété l’analyse. Les résultats de l’enquête mettent en évidence la coexistence de pratiques de terrain fort variées. L’association estime devoir encore faire évoluer les pratiques pour envisager une formalisation de l’accompagnement, identifier les besoins des bénéficiaires en accompagnement post-séjour, travailler à la contractualisation avec le bénéficiaire. Se posent également la question de l’automatisation qui s’oppose au traitement au cas par cas, celle de la durée minimum ou maximum d’un encadrement post-hébergement et, évidemment, celle de savoir comment mettre fin au post-hébergement. L’association travaille aussi à analyser les pratiques de partenariats, le rôle des différents intervenants, la concrétisation du passage de relais et la formalisation de la collaboration. L’objectif est aussi d’estimer les nécessités en matière de personnel affecté au post-hébergement. Quelles seront les missions confiées à ce personnel et quelle devra être sa formation ? Il convient aussi de préciser la délimitation entre le travail de fin de séjour et celui de post-hébergement. À la suite de l’étude, l’AMA émet des recommandations aux pouvoirs de tutelle. L’association estime qu’à Bruxelles, pour aboutir à la reconnaissance de cette pratique d’accompagnement, des changements règlementaires sont nécessaires. Des négociations seraient en cours à la Commission communautaire française (Cocof) et un budget spécifique a été voté pour financer en initiative cette mission en 2016. L’AMA entend poursuivre son travail afin de modifier les textes réglementaires en vue d’une reconnaissance et d’un financement structurel pour 2017. Si je ne me trompe pas, c’était prévu dans le cadre de la déclaration de politique générale. Malheureusement, toujours selon l’AMA, un tel travail n’aurait pas encore été entrepris jusqu’ici à la Commission communautaire commune (Cocom). Selon l’AMA, l’accord de majorité de la Cocom ne serait consacré qu’au volet « urgence sociale et dispositif hivernal » du secteur de l’aide aux sans-abri. L’association souligne le fait que, pour la première fois également, un même ministre – vous en l’occurrence – est en charge de l’Action sociale au niveau de la Cocof et de l’Aide aux personnes en Cocom (conjointement avec votre collègue néerlandophone à qui j’adresse mes meilleurs voeux de rétablissement) et du Logement en Région de Bruxelles-Capitale. Cela l’amène à penser que ce dossier pourrait avancer parallèlement en Cocof et en Cocom, avec un volet logement facilité. Je présume que vous avez connaissance des résultats de cette enquête. Pourriez-vous nous éclairer sur vos conclusions et votre analyse de ces données ? Avez-vous déjà entrepris de prendre en considération les recommandations formulées par l’AMA ? Un travail de mise en cohérence existe-t-il avec ce qui est en train d’être développé à la Cocof ? L’AMA évoque votre double casquette – Aide aux personnes et Logement – qui ouvre de belles perspectives d’évolution cohérente du dossier. Est-ce le cas ? Qu’est-il mis en oeuvre pour faire évoluer ces deux piliers en parallèle dans le cadre de cette problématique ? Vous avez sans doute des contacts avec l’AMA. Le cas échéant, où en êtes-vous dans vos échanges ? Des changements règlementaires dans le sens de la reconnaissance de la mission post-hébergement par une modification de la réglementation sont-ils en préparation ? Mme Céline Fremault, membre du Collège réuni.- Votre question va me permettre de vous informer sur les dernières évolutions en matière de politique d’accompagnement dans et vers le logement des personnes sans abri à Bruxelles. J’ai pris connaissance de l’étude de l’Association des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) intitulée « Le post-hébergement, un accompagnement pour favoriser la transition vers un nouveau milieu de vie ». L’asbl l’a réalisée dans le cadre de ses missions en tant que fédération de la Commission communautaire française (Cocof). Je voudrais d’abord souligner l’utilité de l’étude qui fournit une analyse détaillée des pratiques sectorielles en matière de travail effectuée auprès des usagers à leur sortie de maison d’accueil. Elle nous permet de mesurer l’importance de ce type d’accompagnement dans l’autonomisation des anciens sans-abri au sein d’un logement stable. Nous pouvons également apprécier, grâce à cette analyse, la portée du travail déjà effectué par les maisons d’accueil en post-hébergement. L’étude précise aussi le profil des bénéficiaires, ce qui nous permet de mieux cerner les difficultés sociales auxquelles ils sont confrontés, et d’évaluer l’efficacité des programmes d’accompagnement en matière d’accès au logement et d’autonomisation. La mission de post-hébergement s’inscrit parfaitement dans les objectifs que je poursuis en matière d’Aide aux personnes : sortie durable de la condition de sans domicile fixe via l’accès au logement et ouverture de droits sociaux grâce à un parcours visant l’inclusion sociale. Dans ce contexte, l’étude de l’AMA permet de conforter cette vision en soulignant l’importance que revêt l’accompagnement dans la réussite des programmes d’inclusion sociale. Effectivement, le nouveau décret de la Cocof inscrit la mission de post-hébergement parmi les fonctions centrales et obligatoires des maisons d’accueil. Son financement a été initié en 2016 par des budgets initiatives et sera structurel dès l’entrée en vigueur du nouveau décret prévue au premier semestre de 2017. Le texte est actuellement examiné par le Conseil d’État. J’ai évidemment initié un travail similaire en Cocom sur la reconnaissance de la mission post-hébergement et son inscription en tant que fonction obligatoire des maisons d’accueil. Elle
METIS : AFFAIRE D’ETAT, SECRETS D’ETAT, RACISME D’ETAT
Les métis issus de la colonisation belge en Afrique A l’invitation de l’Association des Métis de Belgique, j’ai eu l’occasion, ce 20 octobre dernier, d’assister à une matinée de réflexion sur la problématique des métis issus de la colonisation belge en Afrique. Entre témoignages, projection documentaire et exposés scientifiques, c’est un autre crime de la colonisation qui a été mis au jour dans l’enceinte du Parlement bruxellois. Loin de l’imagerie habituelle qui entoure cette période, présentant d’un côté le missionnaire belge et de l’autre le colonisé africain, la question des métis nés de relations entre femmes africaines et colons belges reste encore aujourd’hui occultée dans le récit colonial. A l’époque, leur existence-même était perçue comme une réelle épine dans le pied de l’entreprise coloniale, basée sur un apartheid qu’on a pu qualifier de « naturel ». Vus comme des éléments « instables », tout sera fait pour les isoler, les « dénaturer », les remodeler à l’occidentale. Ils seront donc arrachés à leur mère, isolés dans des institutions religieuses, jusqu’à, pour certains, être évacués en Belgique sous de nouveaux noms à l’heure des indépendances africaines. Un racisme d’Etat Outre les souffrances terribles endurées par ces enfants, ces mères et parfois ces pères, ce chapitre de notre histoire met en lumière un système d’état qui ne peut être qualifié que de raciste. La volonté méthodique des autorités d’exclure ces enfants, n’entrant pas dans les catégorisations raciales « reconnues » répond à cette logique criminelle et bien connue de toute entreprise raciste : classer les êtres humains pour permettre au système tout entier de vivre de l’exploitation des uns et des autres. Il en résulte pour les protagonistes des traces indélébiles dues notamment au déni identitaire dont ils ont été les victimes et au silence assourdissant entourant leur histoire personnelle. Coupés de leurs origines, éloignés de leurs parents, de leur fratrie, privés de leur nom et de leur langue maternelle, la plupart ont dû faire des démarches difficiles en vue de retracer leur filiation. Pour certains, cela n’a même pas encore été rendu possible. Et aujourd’hui ? A la lumière de ces faits, il apparait une fois de plus que notre histoire coloniale et les crimes qui l’ont accompagnée ne sont pas encore totalement assumés. Une reconnaissance officielle de ces lourdes fautes du passé est pourtant un « devoir d’histoire » dont notre état ne peut faire l’économie ! Cela passe également par un enseignement du colonialisme dans nos écoles qui se doit d’être plus complet, systématique et critique. Plus que jamais, il est temps d’avancer sur ces matières car ce qui est en jeu, quelles que soient nos origines, c’est notre histoire, et donc notre identité à toutes et tous !
Mon travail porte ses fruits: mise en place d’un site internet contre les crèches illégales
Article de la DH du 15/10/2016. La Région envisage de mettre en place un site Internet permettant aux parents de connaître avec certitude les crèches agréées. Les parents bruxellois pourraient bénéficier, d’ici peu, d’un site Internet leur permettant de savoir avec certitude quelles sont les crèches autorisées et ouvertes dans la capitale. Un outil que mettrait en place la Région bruxelloise afin de lutter contre le phénomène des crèches illégales sur son territoire. C’est ce qu’a indiqué mercredi la ministre bruxelloise Céline Fremault (CDH), en charge des Familles à la Cocom, à la députée Catherine Moureaux (PS), qui l’interrogeait en commission parlementaire des Affaires sociales, sur l’évolution de la situation. « Nous sommes en train de réfléchir à un site Internet qui serait régulièrement actualisé avec mention de toutes les crèches bruxelloises ayant un agrément, soit obtenu via l’ONE, soit via Kind en Gezin (K&G), soit via éventuellement la Cocom. Ainsi, il serait facile pour les parents de vérifier si la crèche où ils souhaitent mettre leur enfant possède bien un agrément officiel », a expliqué la ministre, ajoutant être d’accord avec la députée PS sur la nécessité d’une campagne de communication visant à prévenir les parents de l’existence de la quinzaine de crèches illégales. Depuis le début de l’année, plusieurs affaires de crèches clandestines ont éclaté au grand jour en Région bruxelloise. Chiffres à l’appui, la DH avait déjà révélé en mars 2015, juste après le décès dramatique d’un bébé de 10 mois dans une crèche berchemoise, qu’un certain nombre d’anciennes crèches Kind&Gezin étaient potentiellement ouvertes dans la capitale sans la moindre autorisation. Une situation s’expliquant par un vide juridique auquel la Région devrait mettre fin d’ici quelques mois. L’annonce d’un possible site Internet a, en tout cas, ravi Catherine Moureaux, celle-ci suivant le dossier de près depuis le début. « La ministre avance sur ce dossier et va enfin créer un cadre légal ! Mon travail va donc aboutir à la mise en place d’un site commun ONE – K&G – COCOM qui permettra aux parents d’entrer le nom de leur crèche pour savoir si elle est agréée et par qui. Une avancée majeure qui va faciliter la vie des parents ! », souligne la députée socialiste, appelant néanmoins tous les parents à rester vigilants. J. Th.
« S’opposer au CETA, c’est un sursaut démocratique »
Mon intervention en séance plénière du Parlement francophone bruxellois lors du débat sur la résolution CETA: « Le texte que nous vous demandons de voter aujourd’hui n’est ni anti-Canada ni anti-commerce. Car s’opposer au CETA tel qu’il a été rédigé par la Commission européenne, ce n’est pas une démarche qui oppose les Belges aux Canadiens. Et ce n’est pas une démarche qui oppose les tenants d’une austérité protectionniste à ceux du joyeux commerce. En fait, ce n’est même pas, en tant que telle, une démarche qui oppose un modèle décroissant à un modèle productiviste. Non, s’opposer au CETA tel qu’il a été rédigé aujourd’hui, c’est un sursaut démocratique. Je vais tenter de le démontrer en quelques minutes. ————————————————————————————————————————————– Le Canada est un pays avec lequel nous avons des liens étroits. C’est un pays lointain géographiquement parlant mais très proche dans nos cœurs. Parce que nous partageons une langue nationale qui nous est chère, le français. Mais surtout parce que nous partageons avec nos amis – nos cousins canadiens – une certaine vision de la culture, de l’Etat, et des services publics. Et c’est justement parce que nous partageons une certaine vision de l’Etat et des services publics que nous, citoyens belges, et nos cousins, les citoyens canadiens, partageons les mêmes inquiétudes face au traité de libre-échange « nouvelle génération » qui est sur la table aujourd’hui. J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs représentants de la société civile canadienne. Si le discours, au Parlement de la Communauté française, des ambassadeur et négociateur du Traité pour le Canada étaient très rassurants sur l’unanimité que rencontrait le CETA au-delà de l’Atlantique, les représentants syndicaux et d’associations diverses avec lesquels j’ai pu m’entretenir, et qui représentaient –excusez du peu- près de deux millions de Canadiens de tous les métiers, donnaient à entendre un tout autre son de cloche ! Ils se plaignent de ce que le traité avait été rédigé et signé sans aucune consultation, dans l’opacité la plus totale. Au même moment les mêmes dirigeants signaient le Partenariat Trans-Pacifique alors qu’ils venaient de s’engager à consulter la population dessus. Ils relèvent que les accords de l’ALENA n’ont apporté que dérégulation, faillites et montée des inégalités. Ils demandent qu’avant de traiter tout nouveau traité de ce type, une évaluation sérieuse de l’ALENA soit effectuée. Ils s’inquiètent pour leurs quotas laitiers, pour la vie de leurs mineurs, pour leur culture, notamment pour la culture des Premières Nations. Ils relèvent avec acuité le conflit d’intérêt qui anime une série des hommes politiques impliqués dans la négociation. Ils répètent qu’aucune ouverture ne doit être faite quant aux normes en matière de travail et de santé. Ils expliquent, exemples à l’appui, comment les grandes entreprises canadiennes utilisent un de leurs sièges aux Etats-Unis pour attaquer les lois canadiennes. Ils avaient demandé à leurs négociateurs d’inclure dans le Traité le respect des huit conventions fondamentales de l’OIT, ce que semble-t-il la Commission a refusé ! Et ils expriment de grandes craintes par rapport à la clause de règlement des différends (ICDS/ICS). Ces craintes et ces revendications sont les nôtres ! On voit bien que l’on sort d’un affrontement entre Etats pour entrer dans un affrontement bien plus pernicieux : la lutte pour le pouvoir entre les puissances économiques et les démocraties. ————————————————————————————————————————————- Je vous le disais : s’opposer au CETA tel qu’il a été rédigé aujourd’hui, c’est un sursaut démocratique. J’en veux pour preuve l’opacité des négociations et l’opacité du produit final. L’opacité des négociations, tout le monde est déjà au fait. Mais l’opacité du produit final, je voudrais en dire deux mots. Donc parlons un peu de ces fameuses « listes négatives ». Les traités commerciaux antérieurs faisaient une liste des matières concernées par le traité. C’est ce qu’on appelle le système des listes positives. Les nouveaux traités, CETA, TTIP, TISA, font une liste de ce qui n’est pas concerné par le traité. Donc tout ce qu’on n’a pas explicitement exclus du champ d’application du traité est concerné par le traité. C’est supposé plus simple. Il y a deux bémols : C’est en fait plus compliqué : 3 classeurs, 850 pages, exemple de l’Allemagne; Tout ce qui n’est pas encore connu – nouvelle technologie par exemple – est d’office inclus… Je vous le disais : s’opposer au CETA tel qu’il a été rédigé aujourd’hui, c’est un sursaut démocratique. J’en veux pour preuve le mécanisme de règlement des différends investisseurs-états. S’il a été effectivement modifié ces dernières semaines, il soulève toujours l’inquiétude et une série de questions : Quelle cour d’appel? Quelles assurances contre le conflit d’intérêt? Mais surtout : pourquoi faut-il d’un tel mécanisme ? Les structures étatiques au niveau européen et canadien se ressemblent. L’impartialité de la justice y est reconnue. Dès lors pourquoi inclure ce mécanisme de tiers régulateur chargé d’endosser le rôle de juge entre les parties ? Le négociateur canadien, M.Johnson, explique que c’est parce qu’il faut assurer la célérité et l’expertise du jugement. C’est intéressant. Mais le coût de cette nouvelle instance sera supporté par les Etats et les entreprises. Ces sommes ne pourraient-elles pas plutôt être affectées à nos services publics de justice afin d’accélérer les procédures ? Quant à l’expertise, un raisonnement identique peut être tenu. La question du pourquoi demeure. Et si la mission de ce tribunal d’exception était d’intimider les Etats ? De pétrifier les appareils politiques ? « N’en faites pas trop car des juges extérieurs dont vous ne connaissez pas les outils et la jurisprudence pourraient vous demander des sommes considérables ! » La crainte est loin d’être fanstamatique : quand l’ISDS a été mis en œuvre dans le cadre d’un accord bilatéral ou dans le cadre de l’ALENA, dans la toute grande majorité des cas, le tribunal « tiers » a tranché en faveur des multinationales. Et singulièrement des multinationales américaines en ce qui concerne l’ALENA. La célérité et l’expertise peuvent être acquises par un autre biais. Pour ce qui est de la partialité, c’est peut être plus difficile… Je vous le disais : s’opposer au CETA tel qu’il a été rédigé aujourd’hui, c’est un sursaut démocratique. J’en veux pour preuve la coopération règlementaire. Ce mécanisme vise à
Stop CETA – Texte de la résolution débattue au Parlement francophone bruxellois ce 3 juin 2016
PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada (AECG/CETA)